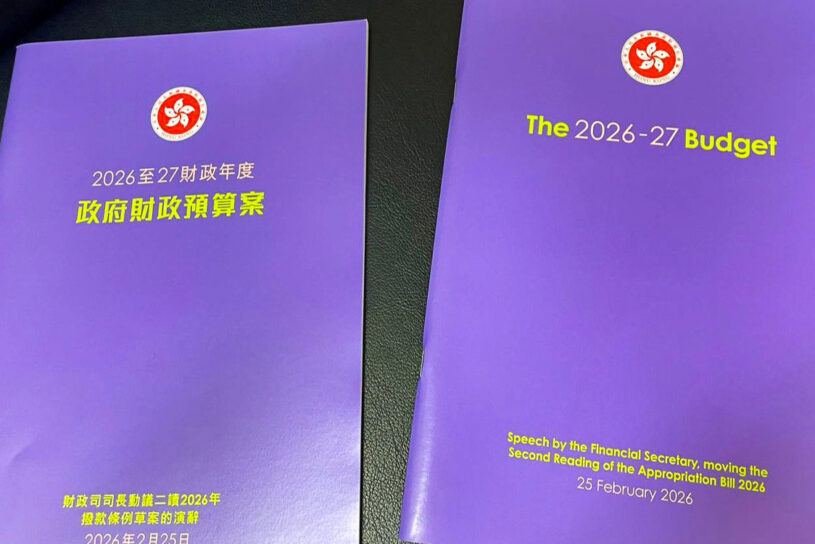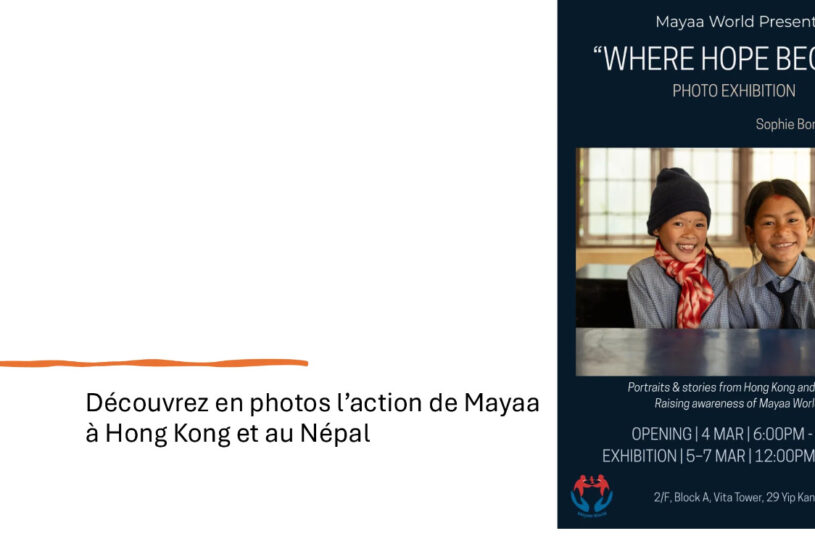Dans l’interview citée dans mon podcast de l’autre dimanche, Olivia Gazalé mentionnait Bergson. Voici la citation, qui portait sur le rire des femmes que la société d’antan, dominée par les hommes et donc patriarcale, interdisait sous peine d’être disgracieuses et frivoles.
“[Le rire est] le contraire de la discrétion, de la réserve, de la pudeur qui sont attendues d’une femme. Enfin, le rire offense la moralité puisqu’il est souvent moqueur. Bergson appelait cela « l’anesthésie du cœur » : le rire de moquerie, ou de dégradation, réclame la mise en sommeil de l’empathie. Donc, ce n’est pas du tout féminin. Comme vous le savez Rebecca, les femmes sont gentilles, douces, dociles et vertueuses, donc elles ne peuvent pas se moquer de leur prochain.”
Sous entendu que les hommes le peuvent et qui ne doivent pas s’en priver, si besoin. Mais laissons cela de côté.
En revanche, inattendu qu’il puisse paraître, le rapprochement entre l’anesthésie du cœur nécessaire dans le rire et la mystique chrétienne qui suppose le contraire me semble d’à propos. D’une part, il introduit dans le débat l’empathie que le rire souvent moqueur met en sommeil en anesthésiant le cœur. Mais ce rapprochement entre le rire et l’anesthésie du cœur conduit surtout à un autre, celui qui se fait entre l’anesthésie du cœur et la mystique. La mystique permet dépasser les simples contours d’un “petit problème” qu’est le rire ainsi qualifié par Bergson pour aller plus loin.
Sous condition d’être réellement relié à “un autre” (prochain et/ou Dieu), l’empathie permet d’aller dans les profondeurs de l’être humain qui cherche à sortir de lui-même pour communiquer avec un ailleurs. Cela peut se faire de façon mystique dans les profondeurs de son être, où il s’abîme sans trop savoir ce qui pourra en résulter. S’abîmer, le correcteur automatique voulait à tout prix me faire changer le verbe par un autre, celui de s’amuser, (c’est amusant n’est-ce pas!?) S’abîmer de façon mystique veut dire, en permettant à l’être humain de faire un voyage ailleurs.
Cet ailleurs, dont le rire moqueur aurait pu solder l’affaire par une note négative en bas de page d’un devoir sur table au sujet des grandeurs et des misères de l’existence humaine. En fait Bergson a consacré une longue étude sur le rire, un essai sur la signification du comique. “les plus grands penseurs, depuis Aristote, se sont attaqués à ce petit problème, qui toujours se dérobe, sous l’effort, glisse, s’échappe, se redresse, impertinent défi jeté à la spéculation philosophique.” (chap I).
Cet ailleurs revendique la reconnaissance de son existence, ainsi enrichie par une rencontre mystique, lui aussi moqué ou pris au sérieux. Les fruits de l’expérience qui en découle ne sont pas sans incidence sur la vie de leur porteur. Ni sur la vie de leur entourage.
Et que dire de la mystique chrétienne à laquelle ce podcast est consacrée. Elle, qui n’est pas vraiment apparentée au rire, et encore moins au rire moqueur. À moins que cela ne soit en lien avec le ricanement moqueur du diable que certains mystiques expérimentent à leur dépens, dont ils sortent vainqueurs; on ignore les récits de défaites flagrantes.
C’est donc par le biais de la recherche de la vérité que le rire fait dénoncer dans ses aprioris surdéterminés (cf podcast précédent) que nous allons aborder la mystique chrétienne selon Berson.
Sa thèse est la suivante: « Le mysticisme complet est celui des chrétiens ». C’est intriguant de savoir qu’un homme d’une telle envergure, épris des sciences naturelles, positiviste dans l’esprit, évolutionniste convaincu, évoluant dans un milieu scientifique un “brin” anticlérical, brillant et déjà à ce titre suspect y compris par l’Eglise catholique qui ne partage pas ses opinions sur l’univers, soit conduit à une telle conclusion.
“Rien, chez lui, ne favorise le christianisme, mais en comparant l’expérience mystique des saints avec celle de figures spirituelles d’autres religions, il finit tout de même par conclure : « Le mysticisme complet […] est celui des grands mystiques chrétiens. ».
C’est sur le site des Raisons de croire que j’ai trouvé cette citation qui m’a incité à faire le podcast. Pour Bergson la conclusion est irrévocable, elle le conduit à reconnaître le christianisme dans son essence, dans son noyau dur, le plus essentiel qu’il soit.
Nous y apprenons aussi que “Ainsi arrivé au seuil de la conversion, il ne demande toutefois pas le baptême, préférant rester solidaire des Juifs persécutés par le régime nazi, mais sa conviction personnelle est faite en faveur de la vérité du christianisme.”
Les raisons d’y croire continuent :
- Bergson est un intellectuel brillant et renommé : quatre fois lauréat du concours général, normalien, titulaire d’un double doctorat en lettres et en philosophie, d’un doctorat honoraire en sciences de l’université d’Oxford et d’un doctorat en lettres de l’université de Cambridge, professeur au Collège de France, membre de l’Académie française, membre de plusieurs académies étrangères (Turin, Suède, États-Unis), prix Nobel de littérature (1928), grand-croix de la Légion d’honneur…
- Dans les premières années de sa célébrité, l’Église lui est même plutôt hostile, condamnant ses livres à l’Index (c’est-à-dire interdisant aux fidèles de les lire (RK-Index librorum prohibitorum, supprimé en 1966)) : Bergson a donc toutes les raisons d’en vouloir au catholicisme.
- Mais son honnêteté intellectuelle est plus forte ; son étude comparée des différentes formes de mystiques conclut que seul le mysticisme chrétien possède, au-delà de la contemplation, de si admirables fruits dans l’action : « Qu’on pense à ce qu’accomplirent, dans le domaine de l’action, un saint Paul, une sainte Thérèse, une sainte Catherine de Sienne, un saint François, une Jeanne d’Arc, et tant d’autres. » Selon Bergson, cette vitalité surabondante est le signe que ces grands saints chrétiens ont atteint le véritable sommet mystique, l’union à Dieu.
- Bergson étudie aussi les mystiques non chrétiennes (notamment les mystiques antiques et celles de la culture indienne) : lorsqu’il conclut à la supériorité de la mystique chrétienne, c’est en toute connaissance de cause.”
- Au centre de sa réflexion est (L’Évolution créatrice 1907) la vie et de ce qu’il appelle « l’élan vital ».
Je m’étais personnellement intéressé à ce terme d’élan vital en l’adoptant dans ma manière de réfléchir. L’élan de la vie pousse à sortir de soi, comme un bébé qui sort du ventre de sa mère et qui en est séparé par la coupure du cordon ombilical, dont la trace reste dans le corps du nouveau-né et pour tortue sa vie. C’est cette marque qui m’a toujours intriguée, jusqu’au moment où j’ai compris que cela même constitue le véritable lieu et le signe d’ouverture à l’extérieur de ma vie personnelle. Ouverture qui peut conduire jusqu’à reconnaître des zones d’existence chez les autres favorables à l’élan mystique.
Je l’avais fait sans trop savoir comment cela pouvait conduire à la mystique, ou plutôt comment cela pouvait faire découvrir la dynamique d’élans mystiques de la vie qui sommeillaient en moi. Ce qui comptait, c’était prendre en compte la vie telle qu’elle se manifestait avec sa matérialité corporelle et ses élans contradictoires, mais qui inévitablement poussaient vers la mystique véritable.
Pour rester dans ce registre, constatons que Bergson s’intéresse notamment à ce qui lui apparaît comme un grand paradoxe du vivant et de son élan vital : s’il y a une grande diversité entre les différentes espèces, il y a au contraire au sein de chaque espèce une grande ressemblance entre les individus.
« Vue du dehors, la nature apparaît comme une immense efflorescence d’imprévisible nouveauté ; la force qui l’anime semble créer avec amour, pour rien, pour le plaisir, la variété sans fin des espèces végétales et animales […]. Mais la forme d’un vivant, une fois dessinée, se répète indéfiniment ; mais les actes de ce vivant, une fois accomplis, tendent à s’imiter eux-mêmes et à se recommencer automatiquement. » La conscience et la vie » (1911), publié en 1919 dans L’Énergie spirituelle.
Mais ce qui est le plus important, c’est la suite 👍: “L’homme seul, par son comportement libre et moral, échappe à cette loi de ressemblance et peut produire quelque chose d’original.” Et cette originalité propre à l’espèce humaine ouvre sur la mystique.
L’originalité constatée par Bergson peut avoir des adeptes et des opposants. Le terrain de la mystique est incertain pour les rationalistes, vertigineux aussi bien pour les adeptes que pour les observateurs, apparemment non engagés comme lui. Avant d’y aller, l’étude de la morale et donc des religions qui la produisent et soutiennent semblait un passage logique et obligatoire pour Bergson.
Ce qui gênait avant tout ces pairs, c’était le surnaturel. Le problème est avec le surnaturel que les milieux positivistes rejettent par principe. Ou alors, ils se laissent “berner” par des occultistes estimés pour leurs sources de savoirs supplémentaires ; considérés parfois comme étant du bon aloi, car allant de soi scientifiquement.
Le surnaturel n’est pas seulement un problème chez certains non-chrétiens. Il l’est aussi chez les bons cathos que nous sommes. J’ai eu l’occasion de m’en rendre compte aux détours des discussions avec quelques amis et connaissances lors de mes derniers passages à Paris.
Mais Bergson se singularise, dans sa quête de vérité il va aller jusqu’à prendre en compte l’expérience des mystiques et donc d’admettre l’existence du surnaturel. “Pour lui, en effet, la vie mystique constitue le sommet de cette originalité de l’homme dans la nature.”
“Bergson se livre donc à une étude comparée des différentes formes de mystique à travers les époques et les aires culturelles – étude qui trouve son aboutissement dans son maître-ouvrage, Les Deux Sources de la morale et de la religion, en 1932.
Évoquant l’expérience mystique des Grecs de l’Antiquité, spécialement Plotin, il écrit : « Il alla jusqu’à l’extase, un état où l’âme se sent ou croit se sentir en présence de Dieu, étant illuminée de sa lumière ; il ne franchit pas cette dernière étape pour arriver au point où, la contemplation venant s’abîmer dans l’action, la volonté humaine se confond avec la volonté divine. »
C’est le principal reproche qu’il adresse aux mystiques non chrétiennes : si elles peuvent aller très loin dans la contemplation, elles ne portent pas ces admirables fruits dans l’action que l’on observe chez les grands saints chrétiens. Ainsi, écrit-il, « le mysticisme, au sens absolu où nous convenons de le prendre, n’a pas été atteint par la pensée hellénique ». La mystique de l’aire culturelle indienne, pour admirable qu’elle soit, n’est pas non plus achevée : elle est une mystique « arrêtée à mi-chemin, détachée de la vie humaine mais n’atteignant pas à la vie divine ».”
“Ainsi, avant même de pouvoir porter un jugement sur la vérité de leur foi, Bergson observe que, d’un point de vue strictement rationnel, seuls les grands saints chrétiens ont poussé la mystique jusqu’à son véritable sommet, qui est cette surabondance de vie qui prolonge l’élan vital d’une façon admirable et originale. Il peut donc écrire : « Le mysticisme complet est en effet celui des grands mystiques chrétiens. Laissons de côté, pour le moment, leur christianisme, et considérons chez eux la forme sans la matière. Il n’est pas douteux que la plupart aient passé par des états qui ressemblent aux divers points d’aboutissement du mysticisme antique.
Mais ils n’ont fait qu’y passer : se ramassant en eux-mêmes pour se tendre dans un tout nouvel effort, ils ont rompu une digue ; un immense courant de vie les a ressaisis ; de leur vitalité accrue, s’est dégagée une énergie, une audace, une puissance de conception et de réalisation extraordinaires. Qu’on pense à ce qu’accomplirent, dans le domaine de l’action, un saint Paul, une sainte Thérèse, une sainte Catherine de Sienne, un saint François, une Jeanne d’Arc, et tant d’autres. » Tristan Rivière”
Comme nous l’avons déjà signifié, à ce stade de réflexion et de conscience, Bergson est au seuil de la conversion. Sa conviction intellectuelle de la vérité du christianisme est établie. A l’approche de la mort, il réclame la présence d’un prêtre catholique à ses obsèques. Il demande aussi à ce que rien ne soit dissimulé au rabbin de son adhésion intérieure à la religion chrétienne.
Une note suit la présentation
“Henri Bergson joue un rôle déterminant dans les conversions de Jacques et Raïssa Maritain. Les deux jeunes gens, au début des années 1900, sont profondément désespérés par l’absurdité de la condition humaine, telle qu’elle apparaît dans les philosophies rationalistes qui règnent alors sur le paysage intellectuel français, au point qu’ils envisagent le suicide comme la seule option envisageable. « C’est alors que la pitié de Dieu nous fit trouver Henri Bergson », écrit Raïssa dans Les Grandes Amitiés. C’est leur ami Charles Péguy qui les invite à suivre le cours du grand professeur au Collège de France, point de départ d’une évolution intellectuelle et spirituelle qui, accompagnée aussi par Léon Bloy, les conduit au christianisme.”
—————————
Aller plus loin :
Henri Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, « Quadrige », Paris, Presses universitaires de France, 2013.
————————
En savoir plus :
- Camille de Belloy, « Bergsonisme et christianisme. Les Deux Sources de la morale et de la religion au jugement des catholiques », Revue des sciences philosophiques et théologiques, vol. 85, no 4, 2001, p. 641-667.
- Catherine Chalier, « Bergson : de la conversion religieuse à la conversion philosophique, entretien avec Damien Le Guay sur Canal Académie, 26 avril 2011.
- Jean-Louis Vieillard-Baron, « La conversion de Bergson. Première partie : les voies de la conversion », Transversalités, vol. 140, no 1, 2017, p. 87-97.”
Qu’en conclure?
Que dans l’expérience mystique prime l’amour qui transcende la condition humaine et la place quelque par au-dessus de son animalité pure, ce qui n’a rien de désobligeant à l’égard des animaux.
Et que l’amour ne peut être vécu que dans la liberté absolue que la foi (confiance) introduit pour disparaître à son tour au profit de l’attention encore plus forte car plus fondée à l’égard de l’autre qui est un je (“Je est un autre”).
Et que l’expérience mystique aboutit au sens de celui dont parle Bergson n’est pas limité à la seule religion chrétienne, mais qui y apparaît avec le plus d’acuité. Car il n’y a pas de mystique sans le don de soi, il n’y a pas de don de soi sans l’amour qui transcende tout.
———————-
Photo : © CC0 pxhere