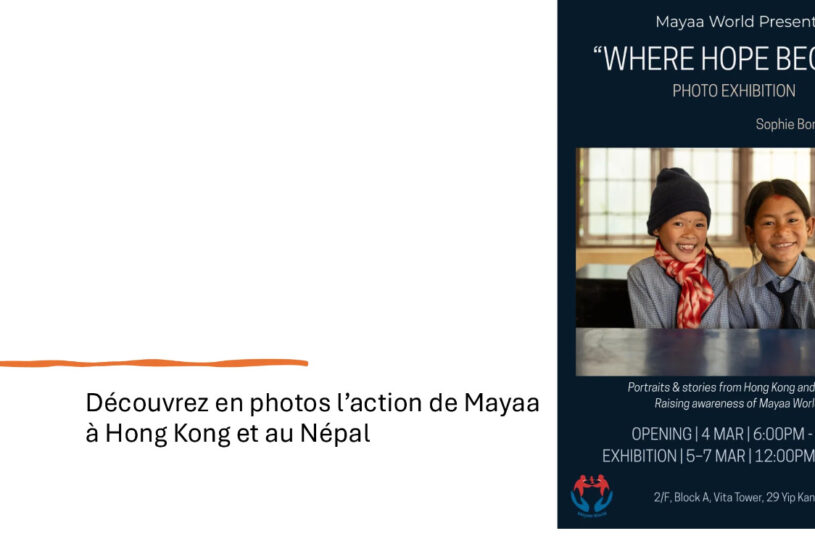Après l’interview de la semaine dernière, en prolongement et en complément, je propose ce podcast. Il est sur le même thème, mais vu un peu différemment.
Comment ? À chacun d’en juger. Il m’était apparu utile de pouvoir rédiger à partir des notes et des souvenirs qui résistent au temps.
Et voici ce que cela donne.
C’est très partiel, mais voilà. La journée des CCF Monde, Communauté catholique francophone. En amont de ces journées, la préparation s’étalait sur plusieurs mois.
Pas de mystère. Pour faire passer le temps de façon utile et agréable, dans la mesure du possible, cela suppose une organisation plutôt rigoureuse. Et surtout, cela suppose une vision claire de ce que l’on veut faire.
Les journées qui se déroulent d’une année sur l’autre, ont un schéma semblable. Après l’accueil fraternel, deux ou trois journées de travail, en grand groupe et en petit groupe, avec des longues poses pour les échanges informels. Le café, le thé, aident à délier les langues et à trouver des connivences.
Chaque année, la rencontre avec l’évêque du lieu et une visite à l’ambassade ou au consulat enracine l’événement localement, tout en signalant les liens avec la France dans sa structure politique et dans sa structure ecclésiale. Cette dernière, la structure ecclésiale, est aux dimensions universelles.
Tout ceci est assaisonné de quelques visites d’à-propos. La visite du palais de justice de La Haye, cette année, ou il y a quelques années, la visite de la Sagrada Familia à Barcelone ou encore de la Hagia Sophia d’Istanbul. Et bien entendu, des rencontres avec la communauté des hôtes qui se démènent pour rendre les journées utiles et agréables.
Une soirée, y compris dansante à La Haye, pour les plus vaillants, par exemple.
Habituellement, les journées sont clôturées par la célébration de la messe communautaire, avec les rescapés qui n’ont pas encore quitté les lieux, comme pourtant doivent le faire certains en reprenant leurs occupations ainsi interrompues, pressés de retrouver les leurs. La nostalgie du temps passé, ensemble, prend le relais des discussions et des découvertes riches en lumière et émotion.
Et quelques partages succincts s’en suivent dans la communauté que l’on retrouve, chacun la sienne. Mais avant le départ, le premier bilan affleure à la surface de la mémoire et alimente le questionnaire de satisfaction qui sert aux organisateurs de matériaux de base pour alimenter les journées de l’année suivante. À la fin de La Haye, les organisateurs ont demandé aux participants de s’exprimer au sujet de la régularité. Plutôt tous les deux ans, ou on continue tous les ans. Les résultats étaient sans équivoque.
Une rencontre annuelle est un strict minimum pour maintenir des liens, pour faire partie de tout un réseau, pour ressentir les liens fraternels entre les prêtres et les laïcs représentant d’une somme, d’une somme toute petite partie des communautés catholiques francophones par le monde.
Une journée des prêtres. La préparation des journées à La Haye avait une particularité. En plus du travail entre Paris et la ville qui accueillait les trois coordinateurs par continent, les aumôniers des trois villes, Los Angeles, Barcelone et Hong Kong, y étaient associés.
Et ce, dans un but précis. Ils étaient conviés pour réfléchir sur la manière de nous saisir des attentes exprimées dans les bilans des années précédentes de la part des prêtres dans l’exercice de leur mission comme responsable de la communauté.
Ce projet concerne une extension du déjà existant.
En effet, depuis des années, une rencontre entre prêtres est organisée dans les cadres de ces journées. Mais cette fois, une journée entière leur était dédiée. Elle a eu lieu en amont, avant même que les autres participants arrivent, une sorte de prélude pour donner le « là » à la suite.
Le bénéfice premier fut la capacité des prêtres de pouvoir être dans le coup pour accueillir les autres participants laïcs. Nous avons pu le faire non seulement par la réflexion nourrie par les échanges, mais surtout par la prière, du bréviaire et la célébration de la messe.
Le besoin de leur consacrer plus de temps s’était fait sentir depuis bien des années.
La participation très active de l’évêque référent était décisive pour passer d’une vague idée à l’action structurée.
Mgr Lalanne agit en nom de la Conférence des évêques de France pour accompagner l’équipe permanente composée d’un prêtre, d’une laïque salariée et de quelques bénévoles, engagés à temps partiel. Par les visites et l’intérêt qu’il porte aux communautés francophones éparpillées dans le monde, il est signe visible d’ecclésialité.
Comme mentionné, il a associé les trois coordinateurs continentaux, ce qui a permis la concrétisation de ce projet de façon à être certain d’être au plus près du réel. Parmi les plusieurs options envisagées, a été choisie celle de traiter la question de l’identité du prêtre, celle du point de vue de son statut canonique d’abord, puis être attentif à la manière dont ce statut est réellement vécu et porté.
Cela a pu être dans ce statut et réellement reçu et porté.
Cela a pu être mené à bien grâce à la compétence du nouveau responsable du service. Il est prêtre à l’expérience d’accompagnement d’une communauté de migrants en Afrique du Sud, lui-même étant d’origine africaine et aumônier d’une communauté italienne à Paris. Il était donc d’une aide appréciable pour constituer un dossier avec les références canoniques visant à préciser de façon accessible à chacun les contours de l’action pastorale du prêtre envoyé en mission auprès des migrants.
Du statut canonique à la résonance pastorale.
Moi-même, j’ai été chargé de la partie pastorale pour donner une vision globale de la situation des prêtres engagés dans un tel travail.
Sa spécificité tient à la dispersion géographique et à l’isolement culturel, variablement vécu. Dans ce contexte, les liens ecclésiaux sont particulièrement indispensables pour veiller sur une petite cellule du peuple de Dieu. Pour, comme nous le disons dans la prière de la messe, être en lien avec notre pape et notre évêque.
Le premier exerçant la fonction de garant de l’unité de façon générale, le second l’exerce de façon concrète, telle qu’elle est expérimentée dans son diocèse. Le prêtre, et la communauté qui lui est confiée, se trouvent au milieu d’un vaste réseau d’églises diocésaines et de paroisses et d’autres entités ecclésiales. Pour les bons exercices de sa fonction de pasteur, il est décisif pour le prêtre de veiller sur le bon ancrage de sa communauté dans les terroirs locales.
Celui du lien avec l’église locale, là où se trouve la communauté et le prêtre qui la conduit et l’accompagne. Le prêtre est incorporé dans le presbytérium du diocèse local. Il l’est par contrat, lettre d’émission ou d’une autre façon, recommandée par l’église de France ou avec son aval.
Souvent, surtout dans des petites communautés où le prêtre célèbre en français, le lien avec le service de coordination de Paris est assez distendu, voire inexistant.
Quel est le statut de sa communauté ?
Paroisses comme celle des Français à Moscou, Rome, Madrid ou Notre-Dame-de-France à Londres. Pour la plupart, il s’agit des aumôneries avec un statut diocésain de Chaplaincy.
Le lien formel avec le diocèse qui lie le prêtre, et par lui la communauté catholique francophone dont il a la charge, est variable. Cela peut être un contrat, une acceptation plus ou moins tacite, etc. Formel ou pas, le contrat est toujours à être vécu dans la dimension pastorale diocésaine.
Les diverses occasions favorisent de telles rencontres. Extrême pilgrimage à Hong Kong en est une tentative parmi d’autres. Dans d’autres lieux, ce serait la célébration commune avec la paroisse locale pour une fête paroissiale, la participation à un événement diocésain comme célébration de l’année sainte, etc.
Certaines communautés sont mixtes, français, anglais. Les francophones africains s’organisent souvent à part par pays mais s’intègrent dans les communautés françaises où, malgré tout, ils se sentent un peu migrants chez d’autres migrants.
Migrants parmi les migrants.
Le prêtre est pour la communauté. Il partage avec elle le statut de migrant parmi les migrants. Migrant lui-même ou accueillant chez lui des francophones comme lui.
Ce qui est le cas des prêtres francophones natifs du pays qui accueillent la CCF. C’est le cas de New Delhi, de Ho Chi Minh, de Varsovie, de Chicago et sans doute ailleurs. Certains sont des prêtres diocésains, d’autres membres des congrégations religieuses, surtout missionnaires.
En migrants, les prêtres viennent de France pour beaucoup, mais souvent d’un autre pays. Ils sont diocésains ou membres d’une congrégation religieuse. Habituellement, dans les diocèses du monde entier, il y a un service pastoral des migrants.
À Hong Kong, par exemple, jusqu’à peu, il était surtout tourné vers les ressortissants d’autres pays d’Asie ou d’Afrique, les occidentaux étant considérés comme des représentants d’entreprises envoyées à Hong Kong pour occuper des emplois de dirigeants. Depuis peu, ces deux catégories sont invitées à se retrouver dans une célébration commune proposée par les diocèses. La distinction entre les immigrés qui cherchent du travail et les expatriés qui l’ont déjà, c’est un peu comme la distinction entre chrétien et catholique.
Après ces tours d’horizon très succincts, revenons à la journée des prêtres. A été signalée dans plusieurs communautés la zone grise dans les cas des migrants entre les deux parts et l’arrivée dans un autre endroit.
Comment nous les accompagnons ? Un contact facilité avec la nouvelle CCF, une lettre qui accompagne l’arrivée, etc.
Jusqu’à quand accompagner une communauté des migrants qui se sédentarise, les étrangers qui s’installent dans les pays d’accueil, mariage, travail, etc. s’externalisent d’eux-mêmes de la paroisse linguistique d’origine et, faute d’apports nouveaux, untel CCF se meurt et rend l’âme pour renaître ailleurs, autrement.
Il était utile de se rappeler aussi que la paroisse veut dire en grec l’assemblée, la communauté composée d’étrangers, fondamentalement par rapport aux autres non-chrétiens de la cité ou du pays.
Confiance à la base de la foi chrétienne.
Il m’était donné aussi d’animer un des groupes de prêtres.
Les thèmes de la confiance étaient au cœur des échanges. Ils se sentent solidaires de la communauté qu’ils accompagnent. La communion désirée et vécue s’expérimente dans le concret de la vie, mais ils savent qu’ils ont une mission à accomplir dans un contexte souvent inhabituel.
Être envoyé à Tokyo, Singapour ou Hong Kong depuis la France, c’est s’exposer à la réalité riche en nouvelles à découvrir et à apprécier.
Comment les prêtres perçoivent leur rôle et comment pensent-ils qu’ils sont vus par les autres ? Qui suis-je dans la communauté ? Comment je m’y vois et comment je suis vu ?
Les projecteurs tournés sur les prêtres avaient pour objectif de permettre de se retrouver un peu mieux dans son rôle, car le réflexe de ses expériences du passé ne pouvait pas toujours servir tel quel dans l’application concrète des impératifs pastoraux. La messe, la catéchèse, accompagnement d’adultes, tout ceci doit prendre en compte les particularités du lieu et de son entourage.
Le rapport à l’efficacité fait que le temps est précieux et les devoirs d’excellence dans la communication et dans la réalisation des projets se heurtent au réel assumé parfois par les engagements numériquement faibles. Les frustrations prennent parfois place de la joie des vivres. Mais c’est au prêtre de réactiver cette joie que l’espérance chrétienne contient et qui ne demande qu’à se déployer.
S’occuper du prêtre et se permettre à la communauté d’avoir un bon fusible qui tient malgré quelques tensions passagères.
Ce qui m’a frappé dans ces échanges, c’est la solitude du prêtre qui souvent doit mener la barque seule, mais il ne s’en plaint pas. Il cherche souvent maladroitement à savoir comment y remédier.
La prière et la vie relationnelle sont des conditions des bases. Structurer les CCF en les dotant d’un conseil pastoral, d’une EAP, etc., aide le prêtre à exercer sa mission de façon collaborative. Certains ont exprimé leur joie de pouvoir se livrer librement.
La confiance que la fraternité sacerdotale génère est la fondation du bien-être du pasteur.
Pour la première fois, j’ai fortement ressenti cette fraternité avec tous, alors que dans le passé, ce fut le cas avec les vieux briscards de la mission, dont la présence régulière depuis des années a permis de nouer de tels liens. Permettez de nouer de tels liens.
Je livre quelques notes telles quelles.
D’emblée, la confiance est donnée grâce à la foi que nous avons en Dieu.
Il y a une grande souffrance dans l’Église quand il n’y a pas de confiance.
C’est l’approche du contrat, cahier de charge, justifier son travail, où c’est justifié. La confiance n’est pas acquise.
Confiance, oui, mais cela n’enlève pas le besoin d’avoir une vigilance. Par exemple, une lettre de mission, cela nous donne la clarté. Problème de confiance plus la gratuité qui peuvent laisser les choses trop floues.
Exemple du Père, d’une situation difficile.
Comment faire confiance face à certains profils psychologiques ? Les positifs ont été constatés après beaucoup de temps. Difficulté d’une cour autour du prêtre, une structure qui ne peut pas remplacer la moralité. Référence au pape Benoît XVI.
Confiance en Jésus et non pas aux structures. Manque de vigilance, il est coupable aussi.
Comment faire confiance à l’Esprit Saint ?
Question d’ordination des autistes.
Pour vivre dans la communion, notre foi partagée nous donne accès à la confiance. Problème d’un pervers narcissiste.
Il faut fuir confiance et vigilance.
Les dangers de cassure menacent.
Puisque les thèmes de ce jour-là étaient le pardon et la réconciliation, amour et vérité se rencontrent, la justice, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent (Psalm 84).
Nous avons profité d’un témoignage livré par les représentants d’une communauté qui avait à gérer une grave crise en son sein. La manière de le présenter avec délicatesse et discrétion, à qui ne manquait ni amour ni vérité, ne pouvait qu’encourager d’autres qui, éventuellement, sont ou pourront être confrontés à ce genre de tensions.
Dans la société ambiante, le discours en faveur de la violence est frais. Aucune religion ni communauté ne peut le tolérer. Le piège des réseaux sociaux, dont l’incitation à la haine, se referme sur ceux qui lui donnent libre cours.
Heureusement que la foi chrétienne dispose des outils pour dépasser toute trace, même minime, de présence d’un ressenti négatif et ne permet pratiquement jamais à se développer de la sorte. Les communautés francophones sont signes prophétiques d’intégration, d’apaisement et de dépassement des fractures. Elles l’expérimentent parfois, elles l’expérimentent parfois chez elles.
Cela suppose d’appliquer une sorte de diplomatie vaticane, désarmée et désarmante. 184 pays en relation diplomatique. Un nonce qui représente le pape dans l’église locale est un ambassadeur auprès du pays d’accueil, lui aussi un migrant parmi les migrants.
L’église use de tous les outils des cités terrestres pour conduire à la cité céleste. Merci et à la prochaine fois.