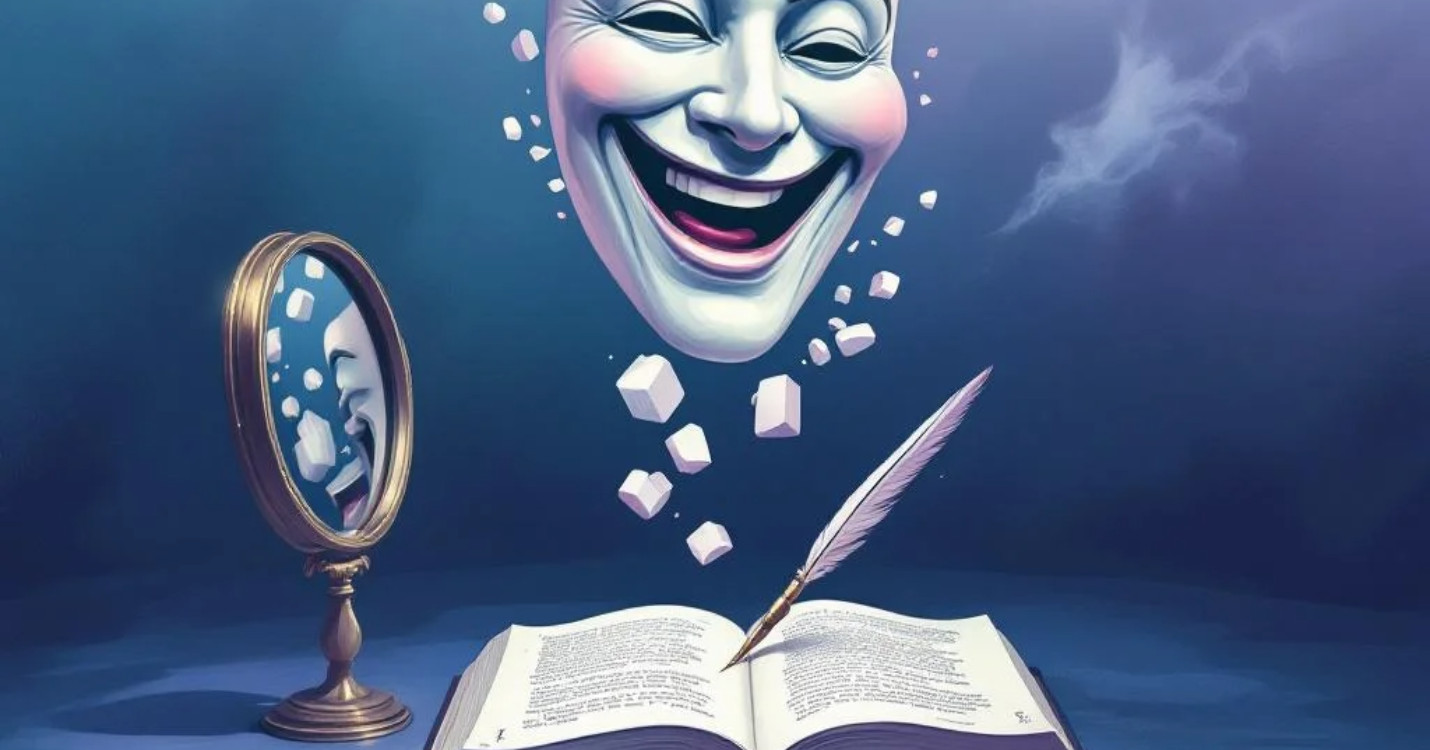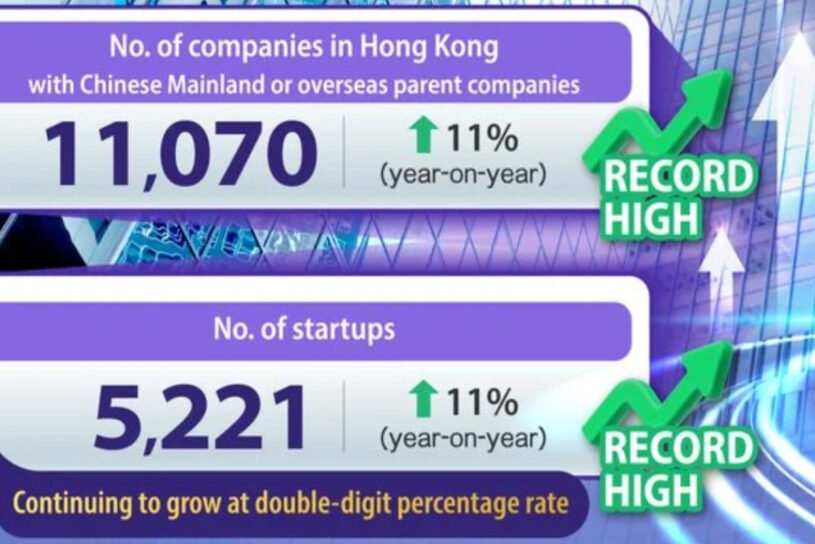Alors que Halloween bat son plein partout à Hong Kong et ailleurs, les catholiques, discrets qu’ils sont, fêtent la Toussaint et les jours de leurs morts. Trois jours et nuits qui se succèdent. Sur ce fond plutôt sérieux, sauf pour le premier (et encore), je vous propose une réflexion sur la vérité dans tout cela. Pas directement, mais par le biais de la question : Peut-on rire de tout, de toute la vérité, prétendue ou pas?
1. Rire de la vérité.
Le titre n’est pas de moi, mais il m’a inspiré. Je l’ai trouvé sur le site des Glorieuses. Tout d’abord, ici je reprends la quasi-intégralité de l’introduction à l’interview.
“Rire de la vérité” – entretien avec la philosophe Olivia Gazalé
Par Rebecca Amsellem
Olivia Gazalé est philosophe. Vous la connaissez sûrement grâce à son ouvrage Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes (Robert Laffont, 2017, Pocket Agora, 2019). Plus récemment, elle a publié Le Paradoxe du rire, Seghers, 2024…
Cet entretien a lieu dans le cadre d’une collaboration éditoriale entre la newsletter et les Rencontres Philosophiques de Monaco – dont la semaine d’événements a lieu du 10 au 15 juin (2025-rk). Philosophes, artistes et intellectuel·le·s se retrouvent cette année autour d’un thème qui nous est cher : la vérité.
… Olivia Gazalé, avec qui nous échangeons aujourd’hui interviendra ce samedi sur le rire et la vérité en compagnie de Mouloud Achour et Gad Elmaleh (19h à 20h30 au Théâtre Princesse Grace) et ce dimanche autour de la vérité des muscles avec Sandra Laugier et Robert Maggiori (11h30 à 13h).
Les conférences peuvent toutes être suivies gratuitement en ligne ici : https://philomonaco.com”
L’introduction se termine par la phrase que je mets en exergue :
“L’ironie fait éclater la vérité. Ou, du moins, va révéler la part de mensonge ou d’illusion ou de contre-vérité, détenue par l’interlocuteur”.
C’est quoi la vérité?
Avant d’entrer dans le vif du sujet ainsi annoncé, je propose une introduction générale qui permet de situer les propos tenus dans l’interview, dont je citerai des larges parties.
Pour me rafraîchir la mémoire et mes connaissances (bien plus que les savoirs) sur la vérité et qu’est-ce que l’on peut faire jusqu’à en rire, je suis allé sur le site indiqué pour voir comment sont traités les sujets débattus sur la vérité.
J’y ai trouvé des thèmes aussi variés et intéressants que fake news et complots, peut-on tout dire (aux enfants, les secrets de familles), la zizanie, le dialogue, le clivage et les conflits, l’espoir fait-il vraiment vivre?, sur la difficulté de vivre et entendre la vérité…
Mais c’est sur la vérité et l’art que mon intuition m’a conduit pour y voir de plus prêt. Dans le cycle de conférences donnés à Monaco, les intervenants ont insisté sur le caractère indispensable de l’art dans la détermination de la vérité. Plus exactement à son indétermination. Car, depuis que l’on a quitté l’idéalisme (moderne?) initié par Leonardo Da Vinci, l’art en général se veut être un lieu de combat avec la surdétermination du concept de vérité.
La fonction subversive de l’art est alors officiellement et fièrement affichée. Pour être abordée dans sa complexité qui échappe aux catégories binaires et prédéterminées, la vérité doit recourir à l’art pour l’illustrer. Ainsi la vérité suppose l’art, comme l’expression de l’indécision, de l’équivoque, pour se tenir sur le bord de la Vérité. Forcer son cadre oblige à aller plus loin que la surdétermination du concept de vérité qui la fige dans un but de conserver sa pertinence surdéterminée et contre laquelle on s’insurge.
(Les opportunistes ont compris que pour être à la fois dans la vérité et dans la contestation de celle-ci, il suffit de prendre le cadre existant et s’y mettre dedans en se déplaçant avec ce cadre sur le sol mouvant. Mais les artistes sont tout sauf opportunistes, ou alors ils se transforment en marchands de leur art.
Je n’ai jamais compris comment on pouvait être à la fois l’un et l’autre, artiste et marchand. Certes, heureux ceux qui savent jouir de telles compétences dans leur entourage de leur vivant, sinon ce sont les pierres, qu’ils laissent sous formes des objets d’art, qui “crieront” la valeur de tels objets d’art méconnus pour être reconnus plus tard après leur mort. Ou jamais! Les cimetières des restes de la mémoire de l’humanité en sont pleins.)
C’est dans le surréalisme que l’on va trouver l’apogée de cette tendance de devoir dire la vérité à l’état de son indétermination. On va le faire en cherchant à se rapprocher le plus possible du chaos préexistant à la création dans lequel l’art doit puiser.
C’est une manière de se libérer de l’élévation imposée par l’idéalisme pour la substituer à la dialectique marxiste d’abord, l’anarchisme en suite, avant de s’écraser dans les tâches d’encre et gribouillis d’un crayon dans l’espoir d’y faire naître des formes intelligibles suivant les codes admis dans ce théâtre, cet atelier de vérité où se côtoient, superposent même l’absurde et le signifiant.
Le surréalisme, et pour une grande part l’art moderne qui s’en nourrit dans sa fonction subversive, cherche à trouver l’inspiration dans le chora, ce chaos précédant la naissance du monde (référence à Platon chez Timé) où les catégories qui distinguent le vraie du faux, le bien du mal, le beau du laid etc., sont abolis et les binômes opposés sont à l’état précédent non existants car leurs contenus sont encore indistinctement, totalement mélangées.
Mais, si dans cette recherche, on supprime la référence à la transcendance divinement habitée (présente dans les religions et certains pouvoirs politiques, et que Platon reconnaît malgré sa préférence pour l’immanence comme résultat d’un monde idéal existant ailleurs), on est forcé de reconnaître que les distinctions entre le vrai et le faux, le bien et le mal sont instrumentalisées, car moralisantes. Et finalement pas très utiles pour la société qui cherche sa propre autonomie.
C’est la soupe primordiale qui sert de référence, le jaillissement d’un volcan qui fait son œuvre d’éruption sans se soucier de savoir qui va en profiter et qui va en souffrir. L’anarchie à l’état pure, indomptable et terrifiante. Sans assumer la responsabilité, car aucune référence au cadre de bonne conduite ne peut être imposé à l’artiste. Dans cette perspective, l’artiste peut, y compris, sombrer dans la non-vérité. Pour se défendre, l’artiste, qui a parfaitement compris que le je c’est un autre (Cf. Arthur Rimbaud) dira, ce n’est pas moi qui parle ; qui va en juger?)
C’est Nietzsche qui va donner le là à cette nouvelle vague d’exprimer la vérité dans l’art. Il parle de la vérité en devenir. Ce constat est d’une importance capitale pour le statut de la vérité, pas tant celui donné par les philosophes mais celui qui est de mise dans les religions et dans l’organisation sociale.
Si la vérité est en devenir, on n’est jamais sûr de rien ? Fricoter avec le relativisme comme l’alternative à la vérité figée ferait basculer d’un extrême à l’autre. Nietzsche a constaté que la certitude rend fou. Il n’a pas vu que l’incertitude aussi.
L’automatisme d’André Breton ou “la paranoïa psychédélique” de Dali s’accroche à la plume de Nietzsche pour ne pas désespérer de la vérité qui n’est pas encore là, mais pour le moment en devenir.
(C’est comme le royaume de Dieu annoncé par Jésus dans les Évangiles, qui est déjà là mais pas encore totalement.
Comment cela s’est-il fait que les chrétiens qui disposent des outils pour approcher la vérité en devenir n’étaient pas capables de le dire avec des mots compris par tout le monde ? Comment cela se fait-il qu’il ait fallu un regard critique à l’égard de leur approche de la vérité (ontologique finalement exclusivement) pour susciter parmi eux quelques tentatives pour explorer cette indétermination dans la vérité avec Kierkegaard, Husserl et Mounier, existentialisme, phénoménologie et personnalisme ?)
Poursuivant Nietzsche, la vérité en devenir est supportable, car la vérité en tant que telle tue. Pour ne pas mourir de la vérité, il faut recourir à l’art, qui à la fois la désigne tout en la dénonçant dans le même mouvement de crayon ou pinceau, et ainsi protéger celui qui tient dans la main le miroir dans lequel l’art lui montre la vérité en devenir.
(Mais il ne faut pas qu’il regarde la vérité en situation totalement devinée ce que la révélation chrétienne prétend. Non seulement parce qu’elle va le tuer, mais aussi parce qu’elle le fera dévier du chemin qu’il doit parcourir à la recherche de la vérité. De fait, le rapport à la souffrance dans le christianisme en donnait des arguments pour dire que regarder trop l’objectif final risquerait d‘oublier le chemin à parcourir.
On le sait, tout comme la vérité elle-même, l’humain est aussi en devenir. La fonction subversive de l’art est enrichie de la fonction dérivative, pour détourner de la vérité pure présente sous forme d’une certitude. Dans la référence transcendantale, la vérité n’est pas soumise aux mêmes conditions de son existence que dans la référence immanente à la vie humaine sur terre.
Du point de vue chrétien, en vertu de la dynamique trinitaire, la vérité est aboutie mais pas figée. Ce qui « sauve « la dynamique trinitaire c’est l’amour. Sans l’amour, en effet cette vérité-là est purement et simplement mortifère, elle tue, car fige.
Rattacher l’amour à la vie de façon si inconditionnelle peut faire grincer les dents de bien de chercheurs de vérité pour se retrouver tant soi peu dans ce monde. La prétention chrétienne n’a d’égal que sa propre nécessité à chercher sa vérité en devenir. Elle l’exprime dans ce que Éph 3 énonce: grandir jusqu’à la stature du Christ)
Or, dans la vision de la vérité qui est en devenir, mais sans référence à l’amour transcendantal, est évidemment logique d’aller jusqu’à attribuer à l’art le droit de tout dire. Donc aussi de rire de la vérité qu’il révèle, cache, dissimule sous les simulacres fantasmagoriques (Dali…). Pour échapper à tout prix aux conséquences de la surdétermination du concept de vérité figée, ce qui, quitte à y insister un peu lourdement, rend fou.
Et on le comprend, c’est comme avoir soif sans l’étancher. Si on trouve une source si longtemps méconnue, négligée qu’est l’être humain lui-même dans sa seule référence à lui-même et ses semblables, on prend le chemin de la vérité en devenant seul. Sans pouvoir l’atteindre un jour. À en désespérer ! Mais avec une joie de libération d’un point de vue de la vérité imposée qui ne correspond pas avec ce que l’on est à ce moment de la vie. Si longtemps attendue. Et tant mieux, c’est déjà cela. Ce n’est pas rien, bien au contraire.
Ce qui a manqué à l’homme jusqu’à l’époque récente – à l’homme méconnu dans sa corporéité pensante – est à grand pas, comblé. Ouvrir l’homme à son devenir, c’est lui permettre d’être en dialogue constant entre ce qu’il est à un moment donné et ce qu’il désire au plus profond de lui-même à être.
Dans cette œuvre dialectique de la vérité entre ce qu’elle est à un moment donné et ce qu’elle est en devenir, sont visés non seulement les concepts philosophiques. Les dogmes religieux eux-mêmes en sont directement et ainsi remis en cause. Cause, à laquelle la plupart des anciens adeptes se ralliaient sans rechigner par l’obéissance à la tradition qui n’est plus de mise dans le monde individualisé et courant les buts bien terre-à-terre.
On voit très bien ce qui est visé : la pertinence de la vérité, l’axiome sur lequel repose toute construction sociale et religieuse.)
2. Alors peut-on rire de toute la vérité?
Si vérité est en devenir (le christianisme le sait, car c’est présent dans son ADN, mais souvent étouffé par les vérités figées qui en sont tirées), elle n’est jamais complète.
Dans la seconde partie, suivent les extraits de l’interview qui se situe sur cette ligne. Avoir la liberté dans la philosophie (y compris théologique), comme dans l’art, pouvoir rire de la vérité incomplète et des convictions qui la figent alors qu’elles nous sont les plus chères.
Allons voir comment cela se présente ici, au travers l’interview d’Olivia Gazalé par Rebecca Amsellem.
“Rebecca Amsellem Dans l’Empire Romain, les “figures d’autorité virile” comme les pères de famille et les soldats” ne pouvaient plus être l’objet de moqueries (et ici, impossible de ne pas penser à la citation de Margaret Atwood “Les hommes ont peur que les femmes se moquent d’eux. Les femmes ont peur que les hommes les tuent)…
Olivia Gazalé…le rire est un contrepouvoir. Quand on fait rire, on fédère autour de soi une armée de rieurs. Une armée de rieurs, est séditieuse. C’est un danger pour la stabilité…
“Rire de la vérité”… : se moquer de la prétention à la vérité… le mot vérités au pluriel, il prend le sens de croyance, de faux savoir, de pseudo-vérité. On parle des vérités révélées, des vérités officielles, des vérités imposées, des vérités toutes faites, dans le sens d’illusions. L’un des premiers à pratiquer ça, c’est Socrate : par l’ironie, il va faire apparaître le fait que son interlocuteur ne sait pas de quoi il parle.
« Rire de la vérité » comme : le rire est révélateur d’une vérité. Quand on se moque, par exemple par la caricature ou par l’imitation, on exagère, on grossit un trait et par ce grossissement, on fait apparaître une vérité qui n’était peut-être pas visible à l’œil nu, une chose à laquelle on n’avait pas prêté attention et dont la vérité nous saute tout à coup aux yeux.
“Plus un pouvoir est autoritaire et absolu, moins il est légitime, et moins il est légitime, plus il redoute la moquerie”.
…Le rire offense trois qualités essentialisées comme féminines. Le rire offense d’abord la beauté, puisqu’il déforme les traits de visage – surtout à l’époque où les dents étaient assez gâtées, noires, etc. Le rire offense aussi la bienséance. Il y a quelque chose d’organique dans le rire corporel, de bruyant, de sonore, …
Le contraire de la discrétion, de la réserve, de la pudeur qui sont attendues d’une femme. Enfin, le rire offense la moralité puisqu’il est souvent moqueur. Bergson appelait cela « l’anesthésie du cœur » : le rire de moquerie, ou de dégradation, réclame la mise en sommeil de l’empathie. Donc, ce n’est pas du tout féminin. Comme vous le savez Rebecca, les femmes sont gentilles, douces, dociles et vertueuses, donc elles ne peuvent pas se moquer de leur prochain.
Rebecca Amsellem Alors que Louis XIV interdit au fou du roi de se moquer de lui, aujourd’hui, le puissant doit savoir rire de soi. On pense à l’anecdote de George W. Bush qui n’a pas esquissé l’ombre d’un sourire lors du dîner annuel des journalistes à Washington où il est commun de se moquer du Président des Etats-Unis lui a valu une élection – intéressant ici de noter que Trump refuse même d’y assister. Le refus du rire de soi est-il une démonstration de pouvoir ou une preuve de fragilité ?
Olivia Gazalé À partir de Louis XIV, l’absolutisme de droit divin réclame gravité, solennité et sacralité. Le Roi Soleil ne veut inspirer que déférence, admiration, dévotion et peur. …
Il y a quatre plans : juridique, médiatique, social et moral. Du point de vue juridique, en France, c’est faux. C’est-à-dire que c’est très rare qu’un tribunal, dès qu’il s’agit de comiques, condamne un propos. Guy Bedos avait traité Nadine Morano de « conne » dans un spectacle comique. Elle a porté plainte et a perdu car le tribunal a considéré que ça faisait partie de son registre comique traditionnel.
D’un point de vue médiatique, les personnes qui ont vraiment le pouvoir de censurer un propos, ce sont ceux qui tiennent les cordons de la bourse (comme Bolloré par exemple, dans l’empire médiatique tentaculaire qu’il contrôle).
Sur l’aspect social, c’est assez complexe parce que les vannes qui ne passent plus sont celles qui stigmatisent des populations ou des individus qui sont déjà discriminés dans la société. Pourquoi ? Parce que depuis une cinquantaine d’années, la sociologie a montré que ces blagues étaient tout sauf anodines et inoffensives….
L’aspect moral revient à poser la question ainsi : peut-on rire de tout ? Je pense qu’on peut rire de tout et qu’il faut rire de tout, qu’on doit rire de tout, mais à condition de le faire avec art. Parce que rire de tout, c’est un art et c’est ce que j’appelle l’art de l’humour… L’humour est ludique, pacifique, inclusif et empathique, avec une part significative d’auto-dérision… Il faut opposer l’humour au sarcasme (qui signifie étymologiquement « mordre »)… les sarcasmes qui visent les individus ou les communautés vulnérables. »
Après ces extraits d’interview, une réflexion personnelle.
Même si on peut rire de tout ce qui vise l’incomplétude de la vérité pour dénoncer la prétention à, mais on ne peut pas le faire n’importe comment. L’art de vivre s’exprime aussi dans l’art de rire. Les bons communicants l’ont compris et en usent et en abusent. Jésus, en bon vivant, s’en est pourtant défendu pour ne pas tomber dans le piège d’être pris pour un tribun qui mène les foules là où elles le veulent.
S’élève et élève les autres qui rit 🧚♀️LEISON ❤️ Qui rit y compris de ceux qui font rire! Jusqu’à rire de la vérité de la vie en devenir? Et même de la mort?
Il ne faut pas confondre Halloween avec Toussaint et Toussaint avec Jour de morts, célébrés ces jours-ci.
La vérité de la mort et de la souffrance, on peut les accueillir, y compris à la légère, mais on ne peut pas en rire. Pourquoi? Parce que nous ne saurons jamais comment s’y accomplit la vérité. Pour ma part, je suppose seulement que c’est dans l’amour. Cela me suffit. Alors que l’amour rend joyeux, par amour, on peut rire de tout, sauf de l’amour lui-même.
Juste avant l’atterrissage à HK, (je rentre des journées mondiales des CCF tenues à la Haye), je regarde le spectacle Gad Elmaleh qui, après sa mort, désire passer par l’église catholique pour célébrer dans la joie sa vie trépassée. La vérité et l’amour se rencontrent, la justice et la paix s’embrassent.
La joie remplace tous les rires qui énoncent l’amour, le suggèrent, le provoquent et y conduisent, mais ne s’y substitue pas.
————————
Photo d’illustration générée par l’IA