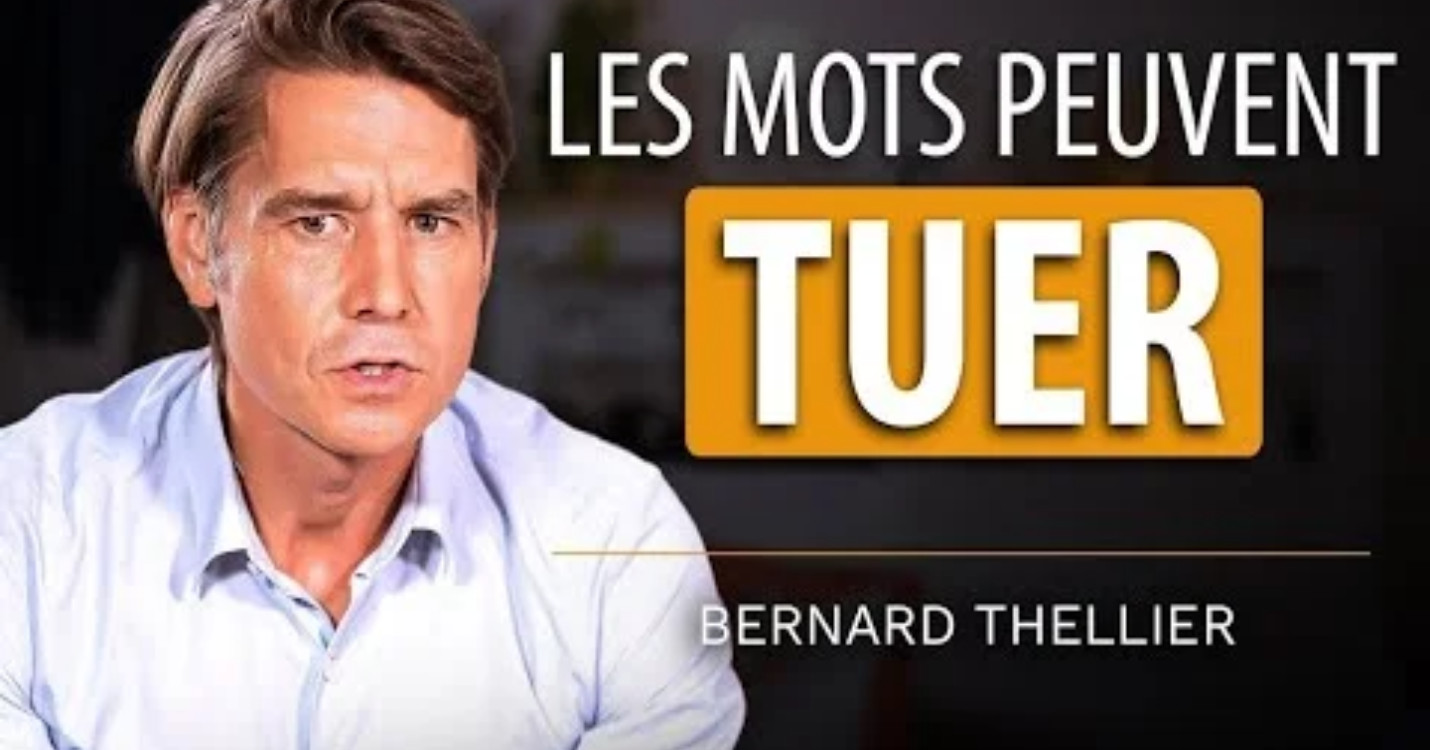Je vais procéder par quelques touches qui ressemblent à des coups de crayons pour esquisser les contours d’un vaste domaine d’action verbale, à laquelle je me limite de façon principielle, sans pour autant passer sous silence certains aspects de la mise en pratique des paroles annonciatrices d’actions concrètes qui n’engagent pas seulement la voix avec ses vibrations, mais aussi les muscles avec leurs contractions.
Dans ce développement je m’appuie essentiellement sur deux textes publiés récemment qui, dans un jeu d’imbrication réciproque, vont me servir de canevas pour la suite de mes observations. Il s’agit d’une interview accordée à la Liberté politique par Daniel Dory, chercheur consultant en analyse géopolitique du terrorisme, et d’une réaction à l’interview postée sur les réseaux sociaux par un spécialiste en psychologie comparative, à Paris II, Bernard Thellier.
D’après Daniel Dory, le terrorisme est avant tout « une technique violente de communication ».
Et voici comment réagit Bernard Thellier:
“Répéter une phrase mille fois… et elle finit par devenir une vérité.
C’est comme ça que l’on façonne les croyances, les certitudes, les foules. Pas besoin de preuves. Juste de la répétition. De la régularité. De l’habitude.
Chaque jour, des idées s’imposent non parce qu’elles sont justes, mais parce qu’on les entend partout. C’est ainsi que l’opinion remplace la réflexion. Que l’émotion prend le pas sur le jugement.
Résister, ce n’est pas rejeter tout en bloc. Ce n’est pas devenir cynique, parano ou méfiant de tout.
C’est rester lucide. C’est exiger des faits.
C’est garder le contrôle de son propre esprit.
Penser par soi-même, aujourd’hui, ce n’est pas juste un droit. C’est un acte de courage.🚀”
« Une technique violente de communication »,
Quelle est l’arrière-fond d’une telle entreprise et à qui profite le crime, ceci n’est pas le sujet ici.
Ce qui m’intéresse, c’est la ou les techniques employées.
La répétition en est une. Mais cela ne suffit pas à obtenir les effets escomptés, à savoir la banalisation et la soumission. Il faut une force de persuasion qui prouve sa meilleure efficacité lorsqu’elle s’effectue en douce. Tout acte pédagogique de bon aloi repose sur ce principe.
Et, comme incite le prof de Paris II, avoir le courage de penser par soi-même n’est-il pas une dangereuse invitation à troubler la douceur d’une vie paisible? Ce n’est pas l’objet de ce podcast non plus.
On le sait, la communication s’effectue en deux phases : les paroles, puis les actes. Les unes et les autres peuvent revêtir diverses formes. Les paroles, pour ne pas se tenir qu’à elles, peuvent être accompagnées de toutes sortes de gesticulations, qui constituent déjà un passage à l’acte, sans oublier que les paroles sont déjà des actes, j’y reviendrai plus loin.
Dans ce podcast je propose de nous concentrer sur la première phase, celle des paroles.
Quitte à le faire un peu lourdement, rappelons-le encore, le terrorisme, qui s’exerce même de manière verbale uniquement, est déjà une technique violente de communication. Et oh combien!
On n’a pas besoin des actes explosifs qui tuent physiquement les uns, blessent les autres et abasourdissent tous. Déjà la communication, verbale et non verbale, ensemble, sert à transmettre une charge émotionnelle négative inspirant la peur afin d’obtenir la reddition et la soumission.
Les mots qui terrorisent sont les mots pris en otage par des auteurs qui les formulent pour leur assigner une charge émotionnelle de violence comparable à un explosif. Violence qui, insinuant la vérité, insuffle la peur et finit par désagréger la solidité d’une vie fondée sur des convictions et des actions sur lesquelles la personne a construit sa vie, mais qui désormais doit composer avec de tels intrus malveillants et autoritaires.
Les intrus malveillants et autoritaires, pour que le cocktail explosif de la violence fonctionne, il faut les deux ensemble, il faut qu’ils soient malveillants et autoritaires. Alors que la malveillance sans autoritarisme, tel le feu qui couve sous la cendre, peut pendant longtemps faire couver la violence, en se joignant à d’autres foyers brûlants, tout en feignant être inoffensive, désintéressée et presque amicale. Cependant seulement pour un temps, même si c’est pour longtemps, ce n’est jamais ad vitam eternam. La réalité est tout autre.
Morts aux…. tagués sur les parois de nos consciences, nous alertent sur les dangers imminents d’un terrorisme verbal, dont les vibrations, provoquées par les bruits des bottes des soldats de la justice « suprême », sont déjà aux portes de notre conscience, menaçant ce qu’elle contient comme trésor, la liberté de penser par soi-même.
C’est comme si l’ange exterminateur de l’Exode était déjà aux portes des élus pour les épargner, alors que les autres sont soumis à sa coupe tranchante visant à ôter la vie de tous les infidèles que nous pouvons être aux yeux des autres et de leurs divinités.
Pour fonctionner, dit l’auteur de l’interview, les auteurs (un groupe, ou entité quelconque) du terrorisme verbal « choisissent des victimes dont la souffrance (ou la destruction s’il s’agit des cibles non humaines) est la plus à même de transmettre un message aux audiences (ennemies, sympathisants, organisations internationales etc.) que l’on cherche à atteindre »
Faire peur, déloger, chasser, ce sont des étapes d’un processus de transformation que toute communication violente vise. Peu importe, si elle se présente sous forme douce ou trash. Chaque fois c’est du terrorisme.
Et tous ceux qui ne l’expérimentent pas vraiment dans leur propre chair, vont la chercher dans les frissons cinématographiques. Jusqu’à assister, dans le cadre d’un programme d’amusement trash, à la mort réelle en direct ou autrement.
Les plans se croisent dangereusement, les distinctions s’embrouillent confusément.
Celui où est brouillée la distinction entre le réel et le virtuel d’une part et celui où est aussi brouillée la différence entre les mots et les actes.
Hélas, souvent la parole précède l’action, comme dans le cas de la mort d’un influenceur en direct, il y a quelques jours, dont la mise en scène a attiré tant de voyeuristes adeptes du trash.
Mais, le projet d’action physique peut être aussi conçu à l’instantanée, y compris sous forme de réflexe de Pavlov, donc de façon justement non réfléchie. Dans ce cas, c’est le plus rapide qui gagne; or, dans ce jeu, le chat est plus rapide que le lion.
La nature fournit bien d’exemples pour prouver que rien n’est évident, pas plus que la distinction entre le réel et le virtuel, ni la violence par la terreur, ni la violence par la « douceur ». Les antidotes à ces deux violences sont disponibles partout chez les victimes, comme chez ceux qui les perpétuent. Parmi ces antidotes se trouve le facteur temps.
Certes, le facteur temps peut jouer en faveur de l’expension du terrorisme, cela se manifeste par exemple dans l’habitude avec laquelle on répète que « tu es un congre et tu le resteras pour toujours », ou en d’autres termes « vous faites partie d’un peuple qui ne peut qu’être soumis à d’autres dans une relation de maître à esclave ».
Mais le facteur temps peut aussi jouer en faveur de l’extinction du terrorisme verbal, à condition qu’on lui prouve son inutilité, ce qui peut s’obtenir par l’usage de la raison que les pacifications psychologiques tendent à obtenir, sans vraiment y parvenir, car l’etre vivant n’est pas pris en compte dans sa globalité ni sa complexité ; il faut de la connexion avec une quelconque transcendance que la science moderne rejete en bloc et au mieux feigne d’ignorer.
La pacification de l’humain à l’aide de toutes les méthodes douces seules, ne réussit pas à satisfaire les profondeurs de l’être. La plupart du temps, cela ne marche pas. Bien au contraire, plutôt que s’en abstenir, nous sommes poussés à montrer à tout prix aux voisins que l’on n’a pas peur d’eux en les matant à coup de bombes larguées, ce qui est un triste aveu de l’impuissance du cerveau en faveur des bras. Par conséquent, l’opinion prime sur l’analyse raisonnable. Le professeur le dit si bien:
« C’est ainsi que l’opinion remplace la réflexion. Que l’émotion prend le pas sur le jugement. »
Or, souvent les techniques sont bien plus subtiles.
L’opinion prime sur l’analyse raisonnable, mais en apparence seulement, car les chaînes de télévisions sont pleines de programmes qui proposent des débats d’opinions nourris des analyses souvent très détaillées. Pour former les opinions, l’adhésion ne dépend pas, comme le suggère le professeur, uniquement de l’efficacité du matraquage médiatique :
« Chaque jour, des idées s’imposent non parce qu’elles sont justes, mais parce qu’on les entend partout. »
L’adhésion s’obtient surtout par une obéissance à l’écoute. Le courage de penser par soi-même peut être affaibli, mais ne sera jamais totalement anéanti.
« Résister, ce n’est pas rejeter tout en bloc. Ce n’est pas devenir cynique, parano ou méfiant de tout. C’est rester lucide. » Résister, c’est rester lucide.
En passant de maison en maison, d’un foyer à un autre, d’une famille à l’autre, en visitant des personnes et des familles de différents bords idéologiques, je constate que les canaux d’informations, grâce auxquels on nourrit les opinions pour les transformer en convictions fermes, sont univoques, les débats d’idées demeurant quasi impossibles, les convictions acquièrent le statut quasi religieux dont les dogmes n’ont pas besoin de justification raisonnable.
Réaction instantanée est impulsive et non maîtrisée, elle n’est pas digne des gens raisonnables, il vaut mieux passer à une violence mesurée, calculée, calibrée sur les besoins, ciblant juste ce qui dérange et que l’on s’apprête à éradiquer chez les autres.
En effet, pour la plupart du temps, le projet est plus ou moins longuement mûri, conçu et mis en place avec préméditation, donc bien médité, longtemps à l’avance. Le terrorisme « explosif » celui qui passe des mots aux actes, sous quelque forme qu’il ne revête (décision d’action directe, ou législative coercitive etc…) n’est que le résultat d’une longue préparation.
Un exemple parmi tant d’autres:
Je suis catholique converti et donc je porte des gages de sincérité, mieux, je porte les gages de vérité dans mon engagement chrétien en politique. Je suis au service d’une noble cause, la vérité de la cause est le prix que je dois payer pour le manque de conformité avec l’Evangile ainsi entraînée. Comme d’autres ne sont pas conformes à la Torah, au Coran etc. Et malgré tout cela, ou peut-être même à cause de cette infidélité religieuse, ils sont les meilleurs serviteurs de la cause commune.
C’est ainsi que peut-on comprendre le sens du témoignage d’un éminent homme politique contemporain qui justifie sa participation à la campagne orchestrée par l’appareil de son État occidental qui vise le dénigrement des uns et l’encensement des autres. Comme toujours, hélas. La violence verbale précède l’autre, celle de l’action, tout ceci est fait pour une bonne cause, celle de la cause, mais laquelle justement est en cause. Que l’on me pardonne ce segment linguistique alambiqué, mais faute de mieux pour être plus précis et plus court…
De l’interview de Daniel Dory qui est consacré au terrorisme d’action ciblée, j’essaie de retenir ce qui peut nourrir la réflection sur le terrorisme des mots.
« Terrorisme n’est pas un ennemi, mais une technique ».
Il est une technique autant pour les mots (formulés à voix basse ou de façon audible de préférence répétés en boucle comme les spots publicitaires) que pour les actions qui en découlent en tant que résultats de projets minutieusement préparés.
Mais n’y a-t-il pas aussi des zones grises, où ni le terrorisme de mots ni le terrorisme d’action ne sont ni bien pensés ni bien conscients?
L’exemple suivant tend à l’illustrer.
Il est dimanche matin, je suis encore en Europe, les alpages suisses tiennent leurs promesses, les forêts se dressent jusqu’aux sommets des montagnes en recouvrants leurs flancs de végétation, des prairies sont données en pâturage aux vaches remuants leurs coups chargés de clochettes qui remplissent l’espace sonore que les rayons de soleil égaient mais qui sans ça demeurerait muet.
J’interromps l’écriture pour aller à la messe dans une chapelle, un lieu de pèlerinage: Notre Dame des Marches, en honneur aux marcheurs qui daignent s’y arrêter pour reprendre leur souffle, souvent sans dire un mot. Pour ma part, le but de mon séjour ici n’est pas vraiment le pèlerinage au lieu saint marqué par la prière reconnaissante, pénitente et pétitionnaire.
J’y suis pour rendre visite à un confrère et ami qui, pour le début de sa retraite marquée par des accros de santé, vient d’y trouver un “refuge” autorisé par sa hiérarchie. C’est au bout du monde, mais un bout que beaucoup, parmi les communs des mortels, ne peuvent même pas imaginer comme possible, la beauté du lieu, le calme et l’air pur d’ici ne courent pas les rues de nos métropoles. Mais ce n’est pas d’une quelconque zone grise ici trouvée à l’intérieur de l’Eglise et où de la société dont je voudrai parler. Mais de celle qui opère dans la marge entre l’extérieur et l’intérieur de la réalité de l’Église elle-même.
Je suis dans l’assemblée, le privilège que je m’octroie lorsque je suis en vacances. Devant moi une famille avec quatre enfants, ils occupent deux bancs. Comme presque toutes les personnes présentes, ils viennent d’ailleurs, mais encore de plus loin, de l’étranger non francophone. Les trois plus âgés occupent un banc, le quatrième avec les parents occupent le banc de devant.
Le comportement des trois ados me fait réfléchir sur le terrorisme des mots dans l’Eglise, dans une religion, dans un groupe auquel l’on n’adhère pas forcément, avec l’usage de la liberté de réflexion de moins en moins évidente mais de plus en plus réclamée, ce qui est le chemin ordinaire de tout adolescent.
Le dernier de la fratrie, visiblement ravi d’être à côté de son père, par son comportement ne semble pas ravir le plus grand qui, mécontent, lui assène des gestes de rappel à l’ordre de se tenir correctement, c’est-à-dire ne pas se retourner en arrière, ce que le petit fait de temps à autre, comme s’il voulait ainsi obtenir la grâce de reconnaissance pour sa présence gentiment remuante et ses appels ainsi exprimés à faire passer pour le crédit de sincérité de sa présence participative dans ce lieu et à cette occasion.
Alors que la mère veille sur la bonne tenue et la participation de trois autres, en se retournant (elle aussi) de temps à autre avec un message clair, mais qui pour la plupart du temps est plus ou moins clairement refusé, ignoré, surtout par l’aîné qui, doté d’une barbichette bien fournie, exprime son malaise de façon à peine poliment ostentatoire. Il n’est pas question de sortir, mais de gagner en autonomie, si ce n’est pas celle d’être ici, tout au moins celle d’y être en état d’autonomie de pensée.
Prêcher à temps et à contre temps n’a rien d’étonnant, c’est même le mandat missionnaire reçu du fondateur. Ont-ils saisi le sens d’un discours pourtant limpide? Vraisemblablement pas grand chose, sinon rien! La dévotion des parents bien visible dans leurs attitudes corporelles est une façon d’exprimer leur adhésion à ce qui se déroule durant la messe.
Y adhérer c’est bien plus que comprendre ce que l’on célèbre et ce que l’on entend. Difficile de parler d’un terrorisme des mots, mais l’autonomie de la pensée peut produire un tel sentiment, un simple ennui a aussi quelque chose d’insupportable pour l’autonomie de la pensée et d’action, il faut préciser, qu’il n’arrive pas à trouver l’issue pour se nourrir avec profit pour la liberté digne de ce nom.
Prêcher c’est mettre les mots sur ce qui est censé exister du point de vue de la religion et ce qui doit en être à l’avenir; tout écart est traité par la cohersition dont le confessionnal et les bons conseils ressemblent, aux yeux de certains récalcitrants, au terrorisme religieux.
Répéter les mêmes prières, faire les mêmes gestes, entendre dire que Dieu aime tout le monde et qu’il veut le bonheur pour chacun, peut obtenir l’adhésion sans trop se poser de questions. Mais une adhésion peu profonde, peu sûre et peu durable. Le terrorisme rompant, expérimenté dans un domaine cède la place à un autre terrorisme, qui présente un visage plus attrayant, pour le moment tout au moins.
Les zones grises existent bel et bien, elles sont habitées par des présences habituées à des rituels qui calment les esprits et, en les rendant plus lucides, permettent de mieux gérer les affres de la vie. Comment alors garder le contrôle de son esprit?
La veille de la messe, nous avons regardé une comédie polonaise des années 2000 U Pana Boga za piecem. À l’abri chez le bon Dieu. Une belle parodie des relations sociales dans la Pologne de campagne où à la fin du régime communiste et au début de la période de transition règne encore l’hégémonie de la religion sur la vie sociale. En bref, c’est le curé qui décide qui sera le candidat des futures élections cantonales etc. Comme le reste, c’est un peu exagéré, mais pas totalement faux. Le pouvoir sur les âmes n’est pas une abstraction philosophico-esthétique.
Mais le clou du film est constitué d’une drôle de manière d’imposer la pénitence à ces paroissiens. Ils reçoivent à leurs frais un pager qui les avertit de l’obligation de faire pénitence, essentiellement sous forme de prière. Ils doivent se connecter alors par téléphone pour enregistrer la prière, afin que le curé puisse constater son exécution, qui pour la plupart du temps est faite machinalement, à toute vitesse.
Terrorisme des mots répond toujours aux impératifs d’influence qui sont toujours connectés à la puissance de l’argent. Ainsi le curé inventif, est si bien inspiré qu’il sauve de la faillite un commerçant qui lui est redevable d’une reconnaissance éternelle traduite de façon circonstancielle.
J’imagine à quel point l’équipe de tournage a dû se marrer en réalisant le script qui auparavant avait séduit déjà le réalisateur et son entourage immédiat. Sous la légèreté, induite par la convention du style de film, se cache une lourde réalité: jusqu’où aller pour exercer l’influence sur les autres. Tous les pacifistes et leurs alliés de la pédagogie positive seront bien en peine de pouvoir trouver une réponse satisfaisante, non pas pour eux-mêmes, mais pour ceux qui, faisant l’usage de la raison, tendent à se rapprocher le plus possible de la réalité telle que la raison aborde, constate, analyse et juge.
Point d’amour dans tout cela, ni dans la description du terrorisme (terrain où il est difficile d’en trouver) ni dans le commentaire.
Mozart disait qu’il composait en cherchant les notes qui s’aiment les unes les autres.
Composons non pas avec le terrorisme, mais avec l’amour.
La philosophie qui n’est que raisonnable et qui veut le demeurer, pour qu’on lui donne raison, a besoin de la théologie (chrétienne, parce que c’est la seule que je connais un tout petit peu mieux que celles des autres religions) pour introduire les notes qui s’aiment.
Encore une utopie… à qui on aimerait tant (comme pour la philosophie) donner raison sans violence aucune et en se passant des anges exterminateurs!